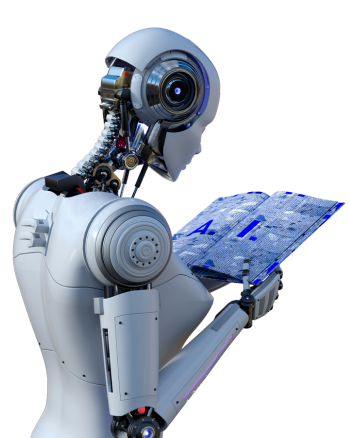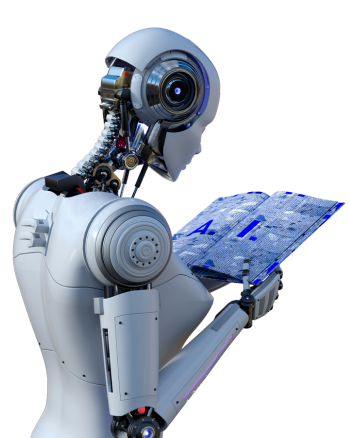
C’est le cœur même de la Loi Avia, laquelle avait été définitivement adoptée par l’Assemblée Nationale le 13 mai 2020 et qui devait entre en vigueur le 1er juillet prochain, que le Conseil constitutionnel vient de censurer.
Dans leur décision du 18 juin 2020, les Sages ont estimé que l’une des dispositions phares de cette loi, à savoir l’obligation pour certains opérateurs de plateforme en ligne de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de 24 heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux (article 1, §2 de la loi), faisaient courir des risques trop importants pour la liberté d’expression.
Parmi les motifs retenus par le Conseil constitutionnel pour juger que la limitation à la liberté d’expression n’est pas « nécessaire, adaptée et proportionnée » à l’objectif poursuivi, on relèvera, notamment :
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que :
« compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Dès lors, sans qu’il soit d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 1er est contraire à la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a également censuré la disposition prévoyant la faculté pour l’autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans un délai d’1 heure (article 1, §1 de la loi).
Les Sages ont estimé que le fait que (i) la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste mais sur la seule appréciation de l’administration, (ii) l’engagement d’un recours contre la demande de retrait ne soit pas suspensif, (iii) le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer et que (iv) l’hébergeur ou l’éditeur est susceptible d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 euros, porte à la liberté d’expression « une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».
La censure de ces dispositions de la loi Avia a entrainé mécaniquement celle des articles 4, 5, 7, 8, 9 et 18 de la loi qui étaient destinés à accompagner la mise en œuvre de ces obligations de retrait.
Personne ne conteste la nécessité de lutter contre la diffusion de propos haineux ; ils ont d’ailleurs été en augmentation exponentielle durant la crise sanitaire du fait notamment de l’usage intensif des réseaux sociaux.
Mais la logique de la loi Avia aboutissait à se passer du juge judiciaire, lequel est pourtant le gardien des libertés fondamentales, et à laisser aux opérateurs privés de plateforme en ligne la responsabilité de juger du caractère haineux d’un contenu sur simple dénonciation et de les retirer dans un délai de 24h seulement sous peine de sanction lourde dès le premier manquement.
Un mécanisme qui ne pouvait conduire qu’à un excès de prudence de la part des plateformes avec un risque d’atteintes généralisées à la liberté d’expression.
C’est ce que le Conseil constitutionnel a notamment mis en relief dans sa décision du 18 juin, comme nous le dénoncions déjà dans notre article publié au moment de son adoption.
Seul résiste donc le volet préventif de la loi Avia qui oblige les plateformes à une obligation de moyens, c’est-à-dire à se doter d’outils facilitant l’identification de contenus illicites.
La copie du législateur est donc presque intégralement à revoir.