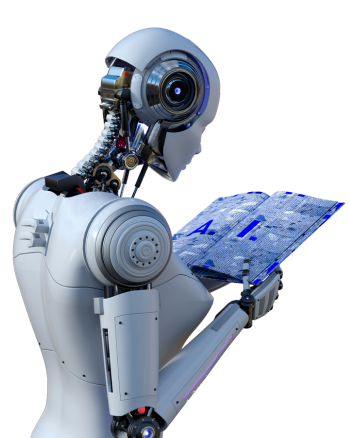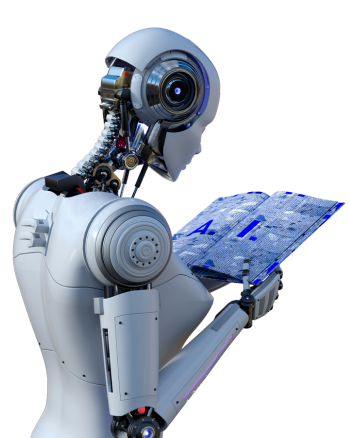
La Cour de cassation vient de rendre un intéressant arrêt quant au champ d’application de la licence légale prévue à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 2° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ». C’est cette notion de publication à des fins de commerce qui était en l’espèce discutée.
La société Saint Maclou avait conclu un accord avec une société proposant des musiques dites « libres de droits », expression ambigüe qui voulait signifier en l’espèce que leur exploitation était exempte de redevances auprès des organismes de gestion collective, tant sur le terrain des droits des auteurs que sur celui des droits voisins de producteur et d’artistes-interprètes. En pratique, on comprend que cette société proposait une plateforme électronique sur laquelle des artistes musiciens venaient déposer des musiques de leur cru, pour consultation et usage par des clients éventuels, ce qui fut le cas de Saint-Maclou, moyennant partage de la contrepartie financière. La société éditrice de la plateforme garantissait à ses clients une jouissance paisible des contenus musicaux ainsi mis à disposition. Toutefois, la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (SPRE), en charge de la perception de la collecte des redevances liées à l’exploitation des phonogrammes du commerce, s’est manifestée auprès de Saint-Maclou, qui a immédiatement résilié son contrat avec la plateforme en demandant sa garantie.
La question qui se posait était de savoir si les musiques relevaient de l’article L.214-1 ci-dessus. La Cour de cassation répond par l’affirmative : « compte tenu des conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plateforme leurs phonogrammes sous licence dite « Creative Commons », ce texte doit recevoir application ».
La solution est exempte de reproches si l’on prend en considération la lettre même du texte : incontestablement, le fait d’avoir mis en ligne ces contenus musicaux sur une plateforme électronique, aux fins de vente pour des utilisateurs, est une publication à des fins de commerce. La solution est en revanche éloignée du cas concrètement visé par la licence légale: celle-ci dispense d’une autorisation des ayants-droits (producteur et artiste) certains usages d’une musique qui a été précédemment commercialisée, hier chez les disquaires, aujourd’hui sur les plateformes de vente de musique ou de streaming. On parle ici d’une musique qui a été conçue et produite en vue d’être commercialisée pour être écoutée pour elle-même, pas pour sonoriser des magasins ou des lieux publics. On considère alors en effet que le coût de la production a déjà été amorti par la commercialisation principale de la musique, et qu’il y a lieu de dispenser l’utilisateur secondaire de la musique, qui veut seulement sonoriser un lieu public ou des programmes de télévision ou de radio, de contracter avec les ayants droits s’il paye une rémunération équitable. Cela n’a plus vraiment lieu d’être pour une musique qui a été conçue précisément de telles utilisations accessoires, ce que l’on dénomme parfois « musique au mètre ».
À cet égard, cet arrêt ne signifie pas à notre avis que la musique au mètre, spécifiquement achetée pour sonoriser des lieux publics ou des programmes de télévision ou de radio, serait soumise à la licence légale de l’article L.214-1 du CPI. C’est seulement parce qu’au cas d’espèce les musiques avaient été précédemment publiées sur une plateforme Internet que ce régime s’appliquait. Le marché spécifique de la musique au mètre n’est pas mort, il doit seulement ne pas être public, rester… sous le tapis.