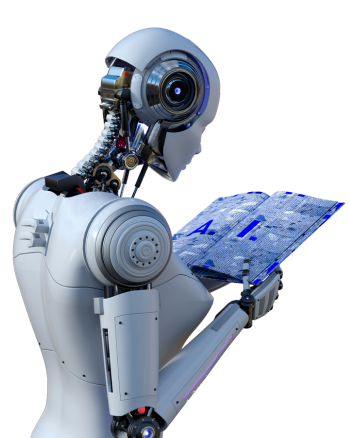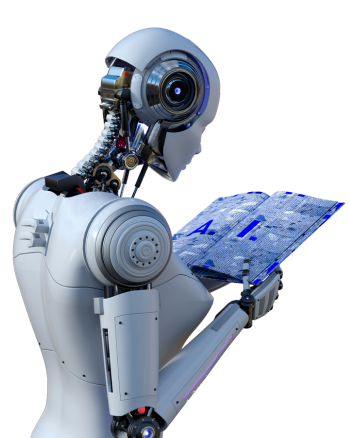
Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, il a été maintes fois rappelé, à juste titre, que la liberté d’expression est la première et la plus absolue de toutes les libertés.
L’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) énonce comme prélude à la liberté d’expression le droit de chacun de ne pas être inquiété par ses opinions et limite leur manifestation au respect du cadre de la loi. Seul le législateur est donc autorisé à limiter la liberté d’expression, afin d’assurer le bien commun. En complément, l’article 11 de la DDHC pose les premiers principes de la liberté de la presse, largement précisés en 1881, et, plus généralement, de la liberté de communication, sans lesquelles la liberté d’opinion ne pourrait être garantie.
Dans ces deux textes fondateurs, l’exercice de ces droits fondamentaux est soumis au respect d’un cadre légal, afin d’en prévenir les abus. En effet, même en subordonnant l’exercice de ces libertés au respect de la loi, les rédacteurs de la DDHC ont restreint son intervention à la détermination de ses limites, au-delà desquels la manifestation d’une opinion devient dangereuse pour les individus et la société. Le rôle du législateur a donc été de s’inscrire en garde-fou, face à la provocation à la haine, la discrimination ou le racisme, en fonction des aléas de l’histoire, jusqu’à créer une liberté d’expression subtile et complexe.
Depuis les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et la communauté juive, les français semblent avoir redécouvert l’importance (pour ne pas dire l’existence) de la première des libertés et ont été des millions à lui rendre hommage. L’achat massif du premier exemplaire du journal satirique démontre à quel point nous sommes attachés à « notre » liberté d’expression que Charlie Hebdo usait dans ses plus lointaines limites. Pourtant, certains ne s’estiment pas autant protégés et sont renvoyés devant les tribunaux pour un « tweet » prétendument humoristique. D’autres se sentent profondément injuriés ou diffamés face aux publications des caricatures du prophète Mahomet, et dénoncent une « liberté d’expression à deux vitesses ».
Les lois françaises ont bâti un corpus de règles strictes permettant précisément de savoir ce qu’il est permis de dire, en posant des limites suffisamment libérales pour permettre la critique, la moquerie, la satire, le débat, d’une part, et résolument sévères pour sanctionner les discours de haine entrainant la violence et les atteintes à l’Humanité d’autre part. Ces règles doivent être rappelées afin de répondre aux interrogations de ces personnes qui se demandent pourquoi la justice accepte la représentation du prophète avec une bombe en guise de turban alors qu’un jeune de 20 ans a été condamné à 5 mois de prison ferme pour avoir déclaré à des policiers « Vive la Kalach’ ! » en mimant une rafale.
Charlie Hebdo a été jugé au regard des incriminations de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionne les abus de la liberté d’expression tels l’injure, la diffamation ou l’incitation à la haine et à la discrimination (I). Les délits d’incitation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme ont quant à eux été récemment transférés vers le Code pénal, afin de pouvoir sanctionner leurs auteurs plus rapidement et plus sévèrement car ils portent une atteinte grave et directe aux fondements de notre République (II).
Avant de reprendre les critères propres à la caricature énoncés dans le jugement Charlie Hebdo de 2007 (B), il convient de rappeler brièvement quelles sont les limites à la liberté d’expression, prévues par la loi de 1881 (A).
La loi du 29 juillet 1881, une loi emblématique, fixant le cadre juridique dans lequel la liberté de la presse pouvait s’exercer, a été votée. Cette loi comprend un corpus de règles assurant un compromis entre d’une part, l’exercice de la liberté fondamentale d’information et d’autre part, la protection des droits des personnes. Cette loi pose un principe de liberté en son article 1er (« l’imprimerie et la librairie sont libres »), mais cette liberté ne pouvant être absolue, elle contient des dispositions afin de sanctionner les abus, avec une série d’incriminations précises, qui s’appliquent aujourd’hui à tous les modes d’expression publics (écrit, audiovisuel, Internet), avec des règles procédurales strictes (compétence juridictionnelle1, prescription de 3 mois2, mise en mouvement de l’action publique3 etc.).
Tout d’abord, l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne l’auteur de toute forme de provocation aux crimes et délits si elle a été suivie d’effet, en tant que complice desdits crimes ou délits.
L’article 24 détermine quelles provocations, même si elles ne sont pas suivies d’effet, sont sanctionnées, notamment celles concernant des atteintes à la vie ou de l’intégrité physique d’une personne et celles incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou [qui] auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ». Ces faits sont passibles d’une condamnation à 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
Par exemple, Brigitte Bardot a été condamnée à une amende de 15.000 euros pour incitation à la haine envers la communauté musulmane pour avoir écrit, dans une lettre au gouvernement au sujet de l’Aïd el Kebir : « Il y en a marre d’être mené par le bout du nez par toute cette population […] qui détruit notre pays »4.
En revanche, Michel Houellebecq a été relaxé du chef d’accusation d’incitation à la haine religieuse. Il avait déclaré, lors d’une interview, que l’Islam était la « religion la plus con ». Ces propos ne revenaient pas à affirmer ni à sous-entendre que tous les musulmans devraient être ainsi qualifiés5.
Enfin, la loi Gayssot a instauré un article 24 bis qui punit des mêmes peines le négationnisme, c’est-à-dire la contestation de l’existence de la shoah.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine également la diffamation et l’injure.
La diffamation, est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
La loi de 1881 opère une distinction entre la diffamation envers les particuliers (art. 32, al.1 de la loi du 1881) et la diffamation à raison de l’appartenance à une ethnie ou une race (art. 32, al. 2), à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle (art. 32, al. 3), la diffamation à l’égard du système judiciaire (art. 30) ou envers l’administration de l’Etat (art. 31), qui sont punies plus sévèrement.
À titre d’exemple, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les propos d’Éric Zemmour selon lesquels « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c’est comme ça, c’est un fait » n’étaient pas diffamatoires à l’égard des personnes noires ou d’origine arabe, au motif que « le seul fait précis et attentatoire à l’honneur imputé dans le propos litigieux est d’être trafiquant. (…) Éric Zemmour ne déclare pas que la plupart des noirs et des Arabes sont des trafiquants (…) il ne vise qu’un nombre très limité d’individus par rapport à l’ensemble du groupe que constituent tous les noirs et les Arabes ».
En revanche, Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la discrimination à raison de l’origine ou de la race à raison de ces propos, ceux-ci ayant été prononcés afin de justifier les contrôles intempestifs sur l’ensemble des individus d’origine noire ou arabe6.
L’injure est quant à elle définie par l’article 29, al.2 comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Il a par exemple été jugé que l’adjonction du mot « crématoire », au nom patronymique d’une personnalité politique, constitue une injure, dès lors qu’elle fait une référence directe au crime contre l’humanité survenu pendant la Seconde Guerre mondiale et outrage ainsi la personne qu’elle vise7.
La caricature permet-elle d’échapper à ces incriminations ? Le genre humoristique, dont la caricature se revendique, autorise-t-il une plus grande liberté d’expression ?
La jurisprudence a dégagé des règles particulières compte tenu de la nature désintéressée de la caricature et de sa participation à un débat d’intérêt général.
La caricature qui consiste à déformer la réalité et à forcer les traits de la personne représentée est une manifestation de la liberté de critique. Elle bénéficie d’un régime de tolérance à géométrie variable, selon qu’elle cible une œuvre préexistante ou une personne.
Dans le premier cas de figure, l’article L. 122-5.4° du Code de propriété intellectuelle permet à l’artiste d’effectuer une caricature, une parodie ou un pastiche d’une œuvre préexistante sans demander d’autorisation préalable, tant qu’il respecte les lois du genre.
Dans le second cas de figure, la liberté d’expression peut se heurter au droit à l’image de la personne caricaturée, qui peut revendiquer la protection de l’article 9 du Code civil. Dans cette hypothèse, la caricature est subordonnée à l’accord de la personne concernée, mais la jurisprudence a assoupli considérablement cette exigence quand la caricature vise des personnes médiatiques.
L’affaire de la poupée vaudou caricaturant Nicolas Sarkozy en est une parfaite illustration. En effet, les juges ont considéré qu’en représentant les traits de l’ancien Président de la République sans son autorisation, l’artiste n’avait pas outrepassé le cadre de la critique politique8. En revanche, l’invitation de l’acheteur de cette poupée à y planter des épingles, comme dans le rituel vaudou, viole le principe de la dignité humaine.
La caricature est régie par les lois du genre satirique, définies par l’usage. Celles-ci réservent la qualification de « caricature » aux représentations originales qui dénotent l’intention de leurs auteurs de faire rire, tout en écartant toute confusion avec le sujet original : « l’art du caricaturiste consiste à maquiller une œuvre afin de la rendre risible tout en la laissant suffisamment apparente de telle manière qu’il n’y ait pas de risque de confusion9 ».
Les lois du genre posent donc des limites à l’admission des caricatures, tenant à l’absence d’intention de nuire et de but lucratif. Les tribunaux sanctionnent le dénigrement pur et simple comme l’injure ou l’offense au président de la République, ainsi que l’outrage à la décence ou l’atteinte à la dignité humaine, comme dans l’affaire de la poupée vaudou.
Dans l’affaire dite des caricatures, les juges ont témoigné de la volonté de trouver un équilibre entre les limites à la liberté d’expression et l’exigence du débat public d’intérêt général.
La 17ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris a jugé notamment, à propos de la caricature publiée par Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet coiffé d’un turban cachant une bombe que « en dépit du caractère choquant voire blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal CHARLIE HEBDO apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées, le dessin litigieux participant au débat public d’intérêt général au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels en se revendiquant de cette religion »10.
Mais qu’est-ce qu’un débat d’intérêt général11 ? Il est possible d’appréhender les contours de cette notion, au regard des critères dégagés par la Cour européenne des Droits de l’Hommes12.
Tout d’abord, un critère spatial : l’intérêt général peut d’emblée se comprendre comme une question qui agite l’opinion publique d’un pays entier. Ensuite, un critère temporel : le bon sens commande de retenir la justification de débat d’intérêt général pour les informations relatives à un débat concomitant à leurs publications. Enfin, des critères factuels : toutes les questions débattues dans l’arène politique, relatives à la justice, à la santé publique, aux faits économiques, à la religion ou encore à des personnalités publiques sont ainsi d’intérêt public.
Quant à la condition tenant à l’absence de but lucratif, elle conduit à opérer une distinction entre une exploitation purement mercantile et le simple exercice de la liberté d’expression. Pour ce faire, les tribunaux vont s’attacher au support de la représentation. La reproduction des traits d’une personne sur des livres et journaux se revendiquera plus facilement de l’exercice de la liberté d’expression, qu’une reproduction sur des santons, des pin’s ou encore des cartes à jouer, qui fait davantage présumer de la volonté d’exploiter la caricature à des fins marchandes13.
L’étude des règles de la loi du 29 juillet 1881 réprimant les abus de la liberté d’expression ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière démontre clairement la volonté de protéger le pluralisme des idées, tout en réprimant les discours haineux, discriminant et gratuit à l’égard d’un groupe ou un individu.
À côté de ces règles, il en existe d’autres, qui ont été récemment transférées dans le Code pénal, destinées à lutter contre les risques majeurs d’atteinte à la sécurité publique. : les délits de provocation et d’apologie du terrorisme.
Il y a des intérêts qui méritent une plus grande protection encore et des impératifs de sécurité publique qui justifient qu’un régime différent de celui prévu par la loi sur la presse soit appliqué.
La détermination de ces intérêts relève là encore des pouvoirs du législateur, qui a récemment fait basculer dans le Code pénal les délits de provocation et d’apologie du terrorisme afin d’assurer une meilleure protection aux victimes d’attentats sur le sol français (A).
En revanche, le blasphème, qui aux yeux de fanatiques justifierait l’attentat commis par des terroristes contre Charlie Hebdo, n’a aucun fondement dans notre droit empreint de laïcité et de liberté d’expression (B).
La liberté d’expression trouve ses limites lorsque le propos formulé ne constitue plus une opinion mais une menace pour la sécurité publique et les valeurs républicaines.
Les infractions d’apologie et la provocation au terrorisme auparavant réprimées par l’article 24 de la loi alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui sanctionne les abus de la liberté d’expression ont été transférées vers le Code pénal par une loi votée en novembre 2014 et sont désormais incriminées par l’article 421-2-5 dudit Code.
Ce transfert est apparu nécessaire, en réponse aux stratégies développées par les groupes terroristes qui se sont servis d’Internet comme d’une arme, à des fins de propagande et d’endoctrinement en vue de la commission de crimes. C’est pourquoi l’apologie du terrorisme constitue désormais un délit pénalement réprimé en ce qu’il menace l’humanité en tant que telle.
Cette insertion dans le Code pénal permet d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate, ce que la loi sur la presse ne permettait pas. De la même manière, les délais de prescription sont bien plus étendus qu’en matière de presse.
Pour être punie, la provocation ou l’apologie du terrorisme doit avoir été faite publiquement, le caractère public des propos s’appréciant de la même manière que pour l’injure ou la diffamation. L’auteur des faits peut être poursuivi par le Procureur de la République ou par une association d’aide aux victimes du terrorisme. En revanche, un citoyen ne peut porter plainte directement. Le délit est puni de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende, la peine étant portée à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amendes si les faits ont été commis via internet.
Par exemple, après les attentats du 11 septembre 2001, le directeur de la publication d’un hebdomadaire basque qui avait publié un dessin représentant l’effondrement des tours jumelles accompagné de la légende « nous en avions tous rêvé… le Hamas l’a fait », ainsi que l’auteur de ce dessein, ont été respectivement condamnés pour apologie du terrorisme et complicité d’apologie du terrorisme.
La Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu l’occasion de se prononcer en 2008 sur la proportionnalité de cette sanction pénale dans le système législatif français au regard de la liberté d’expression. Tout en rappelant la particularité du « langage inhérent à la caricature, qui peut être une forme d’expression artistique, par définition provocatrice » et la nécessité que la presse puisse « communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion », la Cour avait considéré justifiée la sanction pénale contestée, dans la mesure où ces propos glorifiaient la destruction des États-Unis par la violence, et que ces propos pouvaient attiser la violence et avoir un impact plausible sur l’ordre public dans la région14.
Depuis l’attentat commis contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, le délit d’apologie du terrorisme est malheureusement réapparu sous les feux de la rampe, avec la poursuite de nombreux Internautes – près de 70 – ayant tenu des propos laudatifs sur les réseaux sociaux au sujet des odieux actes terroristes commis sur notre territoire début janvier.
Dans ce contexte, le ministère de la justice a publié le 12 janvier dernier une circulaire tendant à définir l’apologie du terrorisme qui « consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable ».
Certaines voix se sont néanmoins fait entendre contre la pénalisation de l’apologie du terrorisme, qui impliquerait selon eux une condamnation des opinions et non des actes, et aboutirait à la répression d’un délit d’opinion.
Cependant, si la liberté d’expression constitue une liberté fondamentale sans laquelle la démocratie ne saurait exister, il est impératif de pouvoir la limiter, de manière proportionnée, lorsque l’expression d’une opinion ne consiste plus à faire l’usage de sa liberté mais à en abuser, pour propager une haine de la République et de ses valeurs les plus fondamentales. La sauvegarde des intérêts républicains impose cette limite.
Ainsi, les individus qui se rendent coupables d’incitation à la haine ou d’apologie du terrorisme abusent de leur liberté d’expression et constituent dès lors une menace pour la démocratie, la sécurité publique, l’ordre social. C’est dans cette seule mesure qu’il est justifié qu’un individu soit limité dans l’exercice de cette liberté fondamentale.
Reste à savoir, pour terriblement choquant que puisse être les propos tenus par certains à la suite des attentats du 11 janvier, dont Dieudonné, qui sur sa page Facebook écrivait le jour de la grande marche républicaine « Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, Je me sens Charlie Coulibaly », si ce délit était à chaque fois véritablement constitué et si certaines décisions rendues n’ont pas été des décisions de circonstances…
L’article 1er de la Constitution de 1958 dispose que la République française « respecte toutes les croyances (…) ». L’Etat doit donc assurer aux religieux l’exercice paisible de leur croyance. Pourtant, l’ordre judiciaire permet le droit à l’outrance de la religion, dès lors que celle-ci remplit des critères précis (Cf. Supra I.B.), limitant de facto l’exercice paisible de celle-ci. Finalement, subsiste une interrogation légitime à l’égard des religieux de France, toutes confessions confondues : est-il possible de se défendre contre les atteintes à ses convictions religieuses ?
Dans son arrêt Otto-Preminger Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, l’ancienne Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) reconnaît un « droit à la jouissance paisible de la liberté de religion », formule qui autorise les Etats membres à sanctionner les injures ou outrages à la religion comme c’est le cas dans plusieurs pays d’Europe. La Cour ajoute cependant que les croyants « doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation de doctrines hostiles à leur foi ». Il est donc possible pour un état de sanctionner le « délit de blasphème » comme le souhaitent des centaines de milliers de croyants musulmans dans le monde à l’égard de la dernière couverture de Charlie Hebdo.
Cependant le blasphème n’est plus un délit en France depuis 1791 puis 1881 (après une réintégration sous la Restauration). Même s’il demeure dans le droit local de l’Alsace-Moselle, aucune condamnation n’a été prononcée de ce chef depuis 1918.
Par exemple, dans l’affaire concernant l’affiche du film « Amen » de Costa-Gavras, qui représentait la croix catholique entremêlée de la Svastika nazie, il a été jugé que « cette affiche est destinée à interpeller sinon à provoquer, à s’interroger sur le rôle que peuvent jouer, dans sa déconstruction, les deux figures [un nazi chrétien et un membre de la Compagnie de Jésus qui cherchent à dénoncer la Shoah] qui l’animent ». L’entremêlement des deux symboles antagonistes permettait d’illustrer le débat sur le silence de certaines autorités ecclésiastiques sous le pontificat de Pie XII, qui demeure l’objet d’interrogations persistantes15.
Le droit français s’applique donc à protéger les individus contre les injures ou les discriminations à raison de leur appartenance religieuse. Il offre aux croyants la liberté d’exercer la religion de leur choix, mais n’interdit pas les outrages à celle-ci dès lors qu’ils participent à un débat d’intérêt général, à l’instar de la vie privée qui peut se trouver limitée par l’intérêt légitime du public. D’ailleurs, rappelons que quiconque a le droit de conserver le secret sur son orientation religieuse.
Celle des laïcs d’un côté et celles religieux de l’autre ? Non, le droit français protège tous les discours qu’ils puissent heurter ou non les opinions, dès lors qu’ils s’inscrivent dans un débat d’idées et n’ont pas pour finalité de susciter un état d’esprit de nature à provoquer la discrimination, la haine et la violence. La liberté d’exercer une religion et la liberté de la caricaturer découlent donc de la même liberté d’expression républicaine et laïque.
Dès la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, l’esprit des Lumières a commandé de restreindre la liberté d’expression à un cadre légal, selon les idéaux républicains de l’époque. Aujourd’hui, la définition des limites de la liberté d’expression par la loi doit permettre de préserver chaque individu de ses abus. Mais avant tout, il est souhaitable qu’un travail éducatif d’explication des raisons de l’existence de ces règles soit mis en œuvre, afin de permettre à la jeunesse de comprendre les bienfaits de notre liberté d’expression.
Même si la prison n’est pas la solution pour sanctionner le tweet malheureux et haineux d’un jeune écervelé, faire l’apologie du terrorisme, ou plus concrètement se satisfaire publiquement de la mort criminelle de dizaines de personnes du fait de leur appartenance au judaïsme ou de leur participation à un journal satirique, est la négation même des principes fondamentaux de notre pays. En ce sens, le délit de provocation et d’apologie du terrorisme se rapprocherait du délit de « blasphème républicain ».
1 Article 45
2 Article 65 sauf dérogations des articles 65-2 et 65-3
3 Article 48
4 TGI Paris, 17e ch., 3 juin 2008
5 TGI Paris, 17e ch., 22 Oct. 2002
6 TGI Paris, 17ème chambre, 18 février 2011, Racisme et a. c/ E. Zemmour.
7 Cass. crim. 20 oct. 1992, no 91-84.253).
8 CA Paris, 28 nov. 2008, n° 08/20155
9 Civ 1ère, 27 mars 1990, Bull. civ. I, p. 54, n°75
10 TGI, 17ème Chambre, 22 mars 2007, 0621308076, voir ici, confirmé par la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 12 mars 2008, n° 07/02873).
11 En effet, la notion a été adoptée successivement par la première Chambre civile (Civ. 1ère 24 oct. 2006, n°04-16.706) et la Chambre criminelle (Crim. 11 mars 2008, n° 06-84.712) de la Cour de cassation, sans pour autant être définie clairement.
12 CEDH, Cour plén, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni, §65.
13 Cass. 1re civ., 13 janv. 1998 ; D. c/ Sté Jag [arrêt n° 49 P].
14 CEDH, Leroy c/ France, 2 octobre 2008.[15] TGI Paris, ord. Réf., 21 février 2002, AGRIF c/ Sté Renn Production et Costa Gavras.